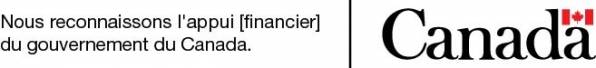Alors qu’on est en train de remplacer le pont Champlain, jeune de seulement quelque 50 ans, j’aimerais vous parler de mon pont Victoria, vieux de plus de 150 ans, encore debout, solide comme le roc de Gibraltar et encore fort utilitaire.
Tout petit gars, dans les années 1940-50 j’allais souvent à la pêche avec mon père sous le pont Victoria à Saint-Lambert. On lançait plusieurs lignes, on accrochait à chacune une cloche et on y prenait des crapets, de la barbotte des perchaudes et même des anguilles.
On se baignait dans le fleuve Saint-Laurent, au pied de la rue Lorne, les gars d’un côté et les filles de l’autre.
Chaque été, on délimitait un espace dans l’eau, un carré formé avec des poteaux de téléphone enchaînés et retenus par des chevalets remplis de roches et de bois.
On avait toujours notre pont Victoria dans notre champ de vision.
J’ai même traversé le pont Victoria à pied avec des copains à plus d’une reprise. À une occasion, on a traversé le pont à pied et on s’est rendu chez Eaton, à Montréal, sur la rue Sainte-Catherine, et on est revenu à pied par le pont Jacques Cartier. Un exploit mémorable, une marche de quelques 12 milles.
Dans les années 1950, il n’y avait qu’une voie routière à double sens sur le pont et je l’ai empruntée à plusieurs reprises, accompagnant l’épicier du coin qui faisait l’aller-retour au Marché Bonsecours pour y acheter ses fruits et légumes.
En 1953-54, je traversais le pont Victoria en tramway électrique du Montreal Southern jusqu’à la gare Youville, sur la rue McGill, pour aller à l’école.
Le pont Victoria me rappelle cependant un incident malheureux où mon père aurait pu y laisser sa peau. Mon père travaillait pour le chemin de fer CN, de l’autre côté du pont, à Pointe Saint-Charles. Lors d’une tempête de neige, alors que son moyen de transport avait été suspendu, il décida quand même d’emprunter le pont à pied pour revenir chez lui, à Saint-Lambert. Par pur hasard, des policiers l’ont aperçu sur le haut du pont; il était rendu à bout de force, épuisé et gelé. En bons samaritains, ils l’ont conduit à son domicile, à la chaleur de son foyer.
1854-1859
La construction du pont Victoria remonte aux années 1854-1859.
Le pont était originalement doté d’une structure tubulaire, c’est à dire un long couloir fermé de tous les côtés par des parois d’acier rivetées – comme un pont couvert fermé. Il n’y avait qu’une seule voie pour tous les trains car le pont était destiné à la circulation ferroviaire seulement.
Le pont mesurait 6592 pieds de longueur (plus de 9000 en comptant les approches).
D’intérêt en 1870, des trous avaient été percés dans le toit et les parois pour faciliter l’évacuation de la fumée.
Le tableau de la structure tubulaire reposait sur 24 piliers fabriqués de gros blocs de pierre de forme biseauté permettant de briser les glaces lors de débâches printanières. Les blocs de pierre provenance des carrières de Pointe-Claire et du Vermont ont occupés jusqu’à 450 tailleurs de pierre!
On dit que les piliers étaient d’une hauteur de 20 mètres mais je ne sais pas quelle partie était submergée, c’est-à-dire jusque’à quelle profondeur on a eu à creuser le lit du fleuve.
D’ailleurs, cela a dû être très difficile d’ériger ses piliers dans le fleuve en cale sèche car le fort courant est très froid. Je le sais car il fallait être un excellent nageur pour être capable de remonter le courant.
Les blocs de pierre étaient renforcés de 24 becs brise-glace en fer très massifs. Je dois admettre que je n’ai jamais remarqué ces coins de bec métallique dans le passé.
Avant d’aller plus loin, je veux vous reparler du couloir tubulaire et de la construction des piliers.
En photo, le pont tubulaire ressemble à un paquet de conteneurs reliés l’un et l’autre et l’ensemble n’est pas nécessairement beau côté architecture. Le tubulaire était d’une largeur de 16 pieds, de même largeur que le tablier du pont. Le toit du tube était en bois recouvert de plaques de tôle en étain. On avait percé des trous dans le toit pour laisser la lumière et évacuer la fumée.
Pourquoi a-t-on choisi un couloir fermé fait de parfois de métal? C’est parce que à ce temps-là, c’était le seul type de pont connu capable de supporter des travées atteignant jusqu’à 330 pieds, comme dans le cas de la travée centrale. Les travées du couloir étaient de 16 pieds de largeur, comme je l’ai dit plutôt, et de 18 à 22 pieds de hauteur et pesaient en tout 9000 tonnes. Les 25 travers avaient une longueur de 70 mètres, soit 228 pieds chaque, à part de la travée centrale qui mesurait 104 mètres, ou 338 pieds.
Pour ériger les 24 piliers, on a dû faire usage de «batardeaux» (coffer dam), c’est-à-dire de caissons coffrages à l’épreuve de l’eau desquels l’eau est pompée pour exposer le fond du fleuve et en même temps destinés à retenir et détourner les eaux pour pouvoir exécuter les travaux à sec. On a eu à utiliser un très grand montant de glaise pour rendre étanche les caissons.
Avant de commencer la construction des piliers, il a fallu excaver la boue et les graviers jusqu’à la roche du fond pour partir sur une base solide et immuable. Est-ce qu’on a coulé une fondation de béton pour niveler le fond avant de poser les blocs de pierre? Le fleuve sous le pont est peu profond près des rives – moins d’un mètre d’une profondeur maximale de 22 pieds dans le chenal principal, dans le milieu sous la travée centrale, d’une largeur d’à peine 90 mètres.
Les immenses piliers étaient de 18 pieds d’épaisseur distancés de 242 à 247 pieds, sauf que les 2 piliers du centre d’une épaisseur de 28 pieds laissaient un espace libre de 60 pieds au-dessus de l’eau et étaient distancés de 330 pieds. Les autres piliers s’élevaient de 15 à 18 mètres hors de l’eau. Ça laissait suffisamment d’espace pour le passage de petits navires en été et pour le gonflement des glaces en hiver.
En 1858, la forme pointue des piliers fit ses preuves car les 14 piliers déjà construits résistèrent avec succès à la terrible pression exercée par la glace qui atteignait jusqu’à 7 pieds d’épaisseur. La pierre calcaire choisie, une pierre très dure, s’avéra un très bon choix pour les piliers et les culées (approches) à chaque bout du pont. Les deux approches étaient également en pierre massives.
Il y a eu jusqu’à 3000 ouvriers en 1858 pour la construction du pont. Des hommes de tous les métiers: riveurs, tailleurs de pierre, maçons, grutiers, mécaniciens, marins, charpentiers, menuisiers et de centaines d’hommes à tout faire. Des anglais, canadiens-français, irlandais et écossais. Même de très jeunes garçons faisaient partie des équipes de riveurs.
Durant les six années, il n’eut que 26 pertes de vie. La plupart de ces hommes se sont noyés en tombant à l’eau, emportés par le courant et les remous du fleuve avant qu’on puisse tenter de les sauver. Il faut comprendre que les travaux étaient extrêmement difficiles et dangereux. Des centaines d’ouvriers et de riveurs travaillaient en hauteur sans harnais ou protection.
On choisit de nommer le pont «Victoria» en l’honneur de la reine Victoria d’Angleterre. Il a été officiellement ouvert à la circulation ferroviaire le 1859-12-12. Il a été considéré comme le plus long pont ferroviaire au monde et également salué comme la 8e merveille du monde.
Incroyable, et cela fut tout un honneur pour Montréal à travers l’Amérique.
Le pont original avait une capacité de 100 trains par jour.
1897-1899
Alors que la première structure tubulaire du pont était devenue problématique, de même que la voie unique de rails, il fut décidé de convertir et élargir le pont de 16 à 66 pieds; construire une nouvelle structure de fermes (poutres d’acier croisées) tout en conservant les assises c’est-à-dire les piliers existants de l’ancienne structures. Sa hauteur passa de 18 à 40 pieds. Cette structure de treillis de fer fut construite par-dessus la partie tubulaire, sans interrompre le passage des trains sur la voie unique existante. Par après, la partie tubulaire fut démontée. La nouvelle structure de fer requis plus 1 million de rivets pour arrimer les poutres.
C’était comme si on avait enveloppé la partie tubulaire d’une structure métallique en treillis pour solidifier et garder le tablier et les piliers en place.
La structure est composée de 24 travées de chacune quelque 250 pieds de long, en plus d’une travée centrale de 350 pieds de long en forme d’or, pour un total de 25 fermes. D’immenses poutres de support ont été suspendues à la nouvelle structure pour élargir le tablier existant et permettent l’installation de deux voies pour la circulation routière en amont et une voie pour les tramways électriques et un trottoir pour les piétons en aval.
Possiblement qu’avec le nouveau pont en 1900, il y avait deux trottoirs, un de chaque côté du pont, comme sur le pont Jacques Cartier. Cela expliquerait que l’on en fit disparaître un en 1909 et que l’on conserva celui relié en aval, à côté de la ligne de tramways.
J’ai lu quelque part que la voie destinée à la circulation automobile en 1900 n’aurait été mise en place qu’en 1927. Je ne comprends vraiment pas ça car j’ai lu ailleurs qu’avant qu’on exploite la ligne pour les tramways, il y a eu un service d’autobus pendant un certain temps entre le Carré Victoria, à Montréal, et Saint-Lambert. On a même dit que c’était le premier service d’autobus au Canada.
La ligne de tramway Montreal & Southern Railways entre Saint-Lambert et Montréal fut inaugurée en 1909.
Incidemment, on a dit dans le journal La Presse à deux occasions, en 1927 et 1997, que le trottoir pour les piétons sur le pont Victoria avait disparu en 1909, mais moi, je peux vous assurer que ça n’a pas été le cas car j’ai moi-même traversé le pont à pied au début des années 1950. C’était un trottoir de madriers de bois avec une rampe (garde-fou) en métal.
Je vous ferai remarquer qu’au début des années 1900 jusqu’aux années 1940-50, la voie pour la circulation routière ne servait pas qu’aux véhicules moteurs mais aussi aux voitures tirées par les chevaux. Par exemple, la boulangerie P.O.M. (Pride of Montreal) venait de Montréal en voiture à cheval livrer son pain à Saint-Lambert.
Le premier véhicule a emprunté la voie réservée aux voitures passa le 1899-12-01.
En 1927, la voie pour voitures en amont fut portée à 16 pieds afin de favorisée le trafic grandissant d’autos.
J’ai oublié de vous dire que jusqu’à 1962, on devait payer – droit de péage – pour traverser le pont.
Fait curieux, j’ai même personnellement livré de la bière discrètement avec mon bicycle aux collecteurs du poste de péage, au pied du pont, à Saint-Lambert.
1955
Le service de tramways entre Montréal et Saint-Lambert a pris fin en 1955-66 et des travaux ont été entrepris pour reconvertir la voie de rails pour une deuxième voie de circulation routière. En même temps, je crois que c’est à ce moment qu’on a éliminé le trottoir pour piétons.
1958-61
@R:Les seuls autres changements eurent lieu lors de la construction de la voie maritime en 1958, alors qu’on ajouta la voie de contournement de Saint-Lambert pour permettre le passage des navires sans pour autant bloquer la circulation automobile.
Depuis lors, à ma connaissance, il n’y a pas eu d’autres changements, sauf pour les travaux d’entretien au coût de plusieurs millions de dollars.
À mon point de vue, le pont Victoria demeure tout un phénomène, un monument national d’une valeur historique inestimable. Il ne reçoit pas toute l’attention qu’on devrait lui accorder. Il faut quand même comprendre que cette merveille de pont demeure encore debout sur ses jambes (piliers) après près de 160 ans. Des milliers d’automobiles continuent à l’emprunter quotidiennement.
Le pont Victoria est exploité par le CN (Canadian National Railway) et demeure de juridiction fédérale. En vertu de la loi fédérale du transport, les camions lourds et les tracteurs-remorques y sont interdits d’accès, car on craignait que les véhicules trop lourds puissent causer trop de vibrations, affectant la structure boulonnée du pont.
Le pont Victoria, un chef d’œuvre, a été déterminant pour l’évolution de Montréal, mais également pour la ville de Saint-Lambert et la Rive-Sud. Il a été la plaque tournante du système ferroviaire canadien. Il a ouvert grandes les portes au marché américain.
Du point de vue architectural, le pont Victoria n’est peut-être pas aussi beau que le pont Jacques-Cartier ou le pont de Québec, mais il a certainement mieux vieilli que le pont Champlain.
J’apprends que le pont Victoria a été déclaré «évènement historique» par Patrimoine Canada et Parcs Canada en 1999, mais il aurait sûrement mérité d’être classé «monument» ou «lieu» historique.
Je crois qu’on devrait penser à refaire un projet d’exposition sur le pont en 2019 pour célébrer son 160e anniversaire, soit plus d’un siècle et demi.
Note
Je me demande comment il se fait que certains ponts n’ont pas de structure par-dessus le tablier? Par exemple, les ponts Jacques-Cartier et Champlain n’ont pas de structure par-dessus une bonne partie du pont.
Est-ce que la structure (fermes truss) (treillis de poutres croisées) du pont Victoria était essentielle pour servir de poids – solidifier et garder la structure de base (le tablier et les piliers) en place?
Il me faudra faire la lumière sur cette question-là!
Je trouve encore le pont Victoria fascinant et mystérieux!
Gaston Guay