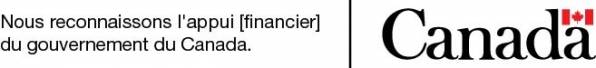LANGUE. Depuis cinq ans, la Longueuilloise Nathalia Akpa arpente les rues de Longueuil, Montréal et autres villes du Québec à la recherche de panneaux publicitaires comportant des fautes d’orthographe. Malheureusement, sa mission s’avère de moins en moins difficile.
Dans son livre à paraître en septembre Le franssais de ma loi 101 aux Éditions Neptunis, la Longueuilloise publiera quelques-unes de la centaine de photos qu’elle a prises depuis le début de son projet. Parmi les pires exemples, elle note le panneau d’un commerce de la rue Sainte-Hélène, où l’on peut lire par exemple «Le petie marcher» plutôt que «Le petit marché».
Mme Akpa, originaire de la Côte d’Ivoire, s’est établie au Québec à l’âge de 12 ans. Cette amoureuse du français ne peut que s’inquiéter des massacres que subit sa langue maternelle, d’autant plus qu’elle remarque une croissance du nombre de fautes de français, que ce soit sur des panneaux publicitaires ou municipaux. «Il n’y pas une journée qui passe sans que je ne voie des erreurs de français quelque part.»
«La qualité du français m’a toujours interpellée, ajoute l’étudiante en création littéraire à l’UQAM. Les erreurs dans l’affichage public, ça m’a toujours irritée. J’ai l’impression que c’est un manque de respect envers la population francophone.»
Pas de contrôle?
Elle s’étonne toutefois que la Charte de la langue française ne comporte aucun article relatif à la qualité de la langue française. Selon la loi 101, le français doit effectivement primer sur l’anglais dans l’affichage public, mais rien n’oblige à l’écrire adéquatement.
«Je comprends très bien l’enjeu de l’anglais, mais pourquoi on ne s’affaire pas aussi à employer correctement notre langue?, questionne-t-elle. L’orthographe sert à reconnaître les mots. S’ils sont mal écrits, il y a un risque que le message ne soit pas compris.»
Nathalia Akpa perçoit dans le peu de souci accordé à la qualité de la langue un signe inquiétant quant à l’avenir du français.
Un manque de soutien
En prenant toutes ces photos et en discutant avec certains commerçants, souvent issus de l’immigration, Mme Akpa s’est aperçue du manque de moyens à la disposition de ces gens d’affaires.
«Ils n’ont pas accès à un soutien qui pourrait les aider. Ces commerçants font affaire avec des entreprises d’affichage, et personne ne vérifie, personne ne contrôle», déplore la Longueuilloise.
Mme Akpa cite par ailleurs une étude de la BBC qui révèle que les fautes d’orthographe contenues sur les sites Internet de compagnies pouvaient se traduire en une baisse de leur chiffre d’affaires, ce qui la laisse croire que les coquilles sur les panneaux commerciaux créent le même effet.
Une fiction et des propos réels
Pour écrire Le franssais de ma loi 101, Nathalia Akpa s’est inspirée d’entretiens concernant la Charte de la langue française qu’elle a eus avec des Québécois. Elle a retenu leurs propos à leur insu, sans les identifier. «Je me demandais ce que les gens pensaient de la loi 101. Les réponses, surtout des Québécois de souche, sont assez étonnantes.»
Bien que certains propos soient réels, l’histoire relatée dans le livre demeure une fiction, le tout étant romancé par l’auteure.
La Longueuilloise a également rédigé l’ouvrage Les inventeurs et scientifiques noirs et a offert une conférence sur le sujet lors du Mois de l’histoire des noirs.
12%
Douze est le pourcentage de plaintes formulées à l’Office de la langue française, notamment à l’égard de l’affichage, en 2013-2014 provenant de la Montérégie.