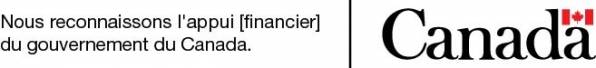Le meurtre survenu à Brossard le 2 février a fait grimper à six le nombre de féminicides survenus depuis le début de l’année au Québec. Des données qui s’inscrivent dans une hausse «alarmante» de ces crimes, dit la sociologue Sandrine Ricci, mais qui ne sont pas le fruit du hasard.
Comment expliquer ce nombre frappant de féminicides commis depuis le début de l’année et la hausse observée au cours des dernières années? Il importe de s’attarder aux potentielles causes de ce phénomène, selon Sandrine Ricci, sociologue affiliée à la Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d’enseignement supérieur (UQAM) et chercheuse postdoctorale.
«Est-ce qu’il y a des parallèles à faire – moi, je les fais – entre la montée de l’extrême droite, d’une idéologie de haine et d’intolérance à tout point vue? Est-ce qu’il n’y a pas des liens à faire – et je les fais – avec la montée du masculinisme, de la popularité accrue des théories masculinistes qui blâment les femmes, qui sont misogynes, etc.?»
Elle ajoute aussi à ces facteurs le coût de la vie. La hausse des loyers peut constituer un frein pour les femmes qui tentent de fuir une situation de violence, sans compter les maisons d’hébergement qui débordent.
«C’est ça qu’on dit, quand il y a des réalités systémiques. Ce n’est pas juste un homme qui a pété un câble et qui a décidé de tuer sa conjointe. Dans leur histoire individuelle, il y a une série de faits qui amènent à ça.»
«Il faut s’interroger sur les moyens qu’on ne donne pas aux femmes de sauver leur vie.» -Sandrine Ricci
Rapport de pouvoir
La sociologue soutient que l’on ne peut prendre les féminicides comme des cas isolés.
Le nom féminicide, qui s’est popularisé au cours des dernières années, est un terme politique et englobant. «C’est pour ça qu’on utilise le terme féminicide. Ce sont des faits qui sont le produit de violences systémiques. Il va tenir pour responsables non seulement des hommes auteurs de violence, mais aussi l’État, les structures judiciaires qui vont normaliser cette violence, qui vont normaliser la misogynie, ou en tout cas qui ne vont pas suffisamment octroyer de moyens pour lutter contre ces phénomènes.»
Le terme évoque aussi les enjeux d’impunité et d’indifférence face à toute forme de violence faite aux femmes. Le terme «est vraiment utile pour déconstruire des systèmes de valeurs qui vont cantonner la violence patriarcale à la sphère privée. Ce que ça amène à voir, c’est qu’il y a une dimension sociale de ces meurtres. C’est le fruit d’un rapport de pouvoir entre les hommes et les femmes.»
Si l’emploi du terme est récent, les recherches sur le phénomène sont nombreuses, tout particulièrement depuis les 60 dernières années. Mme Ricci exhorte le gouvernement à écouter tant les organismes sur le terrain les chercheurs qui s’intéressent à la question.
Des changements culturels s’imposent pour relier ces meurtres à la tendance à banaliser la violence à caractère sexuel, avance-t-elle.
«C’est ça, le fil rouge. C’est vraiment la façon dont les hommes, et la société plus largement – parce que les femmes intériorisent aussi cette idéologie – conçoivent les femmes et comment on considère que ça se traduit dans des espèces de schémas qu’on pense naturels mais qui ne le sont pas.»
La sociologue glisse un mot sur la couverture médiatique de ces tragédies et appelle à une plus grande sensibilisation de la façon de présenter les faits.
«J’ai un titre sous les yeux : Une femme est morte à la suite d’une dispute qui a dégénéré. Elle n’est pas morte à la suite d’une dispute qui a dégénéré : un homme a tué une femme dans un contexte de violence conjugale. Vous voyez comment on édulcore et fait disparaître l’un des deux acteurs principaux? En invisibilisant les acteurs de la violence, on ne se met pas en bonne position pour comprendre que c’est le fruit d’un rapport de pouvoir.»
Accusations retirées
Deux mois avant le drame qui s’est produit à Brossard le 2 février, Sonia Maricela Gonzalez Vasquez a retiré les accusations notamment de voies de fait et menaces qui pesaient contre son conjoint Marcos Amilcar Diaz Lopez.
Il n’est d’ailleurs pas inhabituel que les victimes retirent les accusations dans un contexte de violence conjugale.
«Il importe de se demander pourquoi elles le font. Sous quelles contraintes sont-elles placées? Est-ce qu’il y a des enfants dont on menace de retirer la garde, d’atteindre à leur sécurité, leur intégrité ou leur vie? Est-ce qu’il y a des menaces de divers ordres? C’est vraiment une pratique très fréquente […] que les agresseurs exercent des formes de pression de toutes sortes.»
Donner les moyens
Sandrine Ricci plaide pour que les demandes des maisons d’hébergement et divers organismes sur le terrain soient entendues et que ces ressources soient financées à la hauteur des besoins.
En novembre dernier, l’organisme SOS violence conjugale affirmait n’avoir pu répondre à la moitié des demandes reçues à l’échelle du Québec.
«Il y a des services externes, de l’accompagnement pour aider ces femmes qui veulent rompre la relation. Il n’y a pas de ressources, dénonce Mme Ricci, déplorant que Québec n’ait pas accordé de sommes neuves à ces ressources.
«Quand on ne donne pas les moyens suffisants aux organismes qui soutiennent ces femmes, quand on ne lutte pas pour l’accès à du logement à prix raisonnable, c’est comme ça que le problème se reproduit.»
Longueuilloise, Mme Ricci est l’une des 200 signataires de la lettre en appui au CALACS de Longueuil menacé de fermeture, faute de financement suffisant. «Il faut comprendre le lien qu’il y a entre la violence sexuelle et la violence conjugale, sachant que dans la violence conjugale, il y a beaucoup de violence sexuelle.»
«Peut-être que cette morte de plus sera l’occasion pour la société, pour les autorités, de prendre davantage en sérieux cette problématique et de mieux comprendre ce qui se passe. Et puis, de prendre des engagements plus concrets», espère Sandrine Ricci.